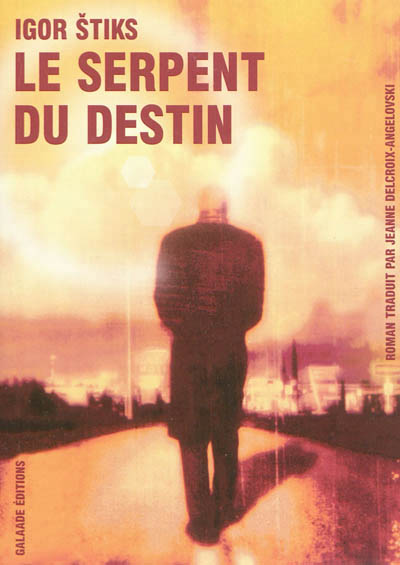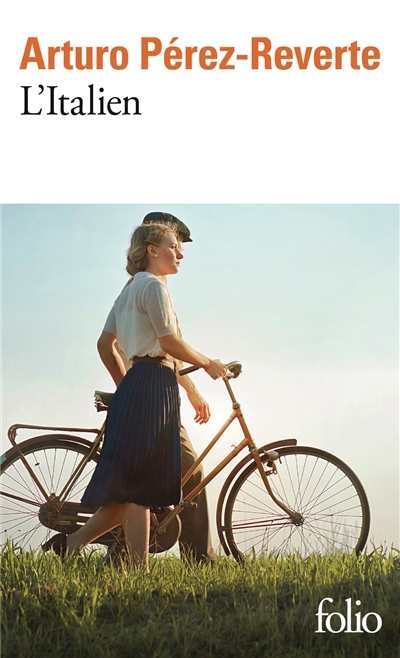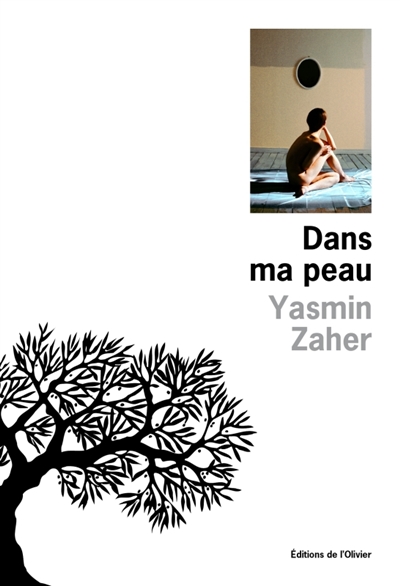PAGE : Dans votre roman Le Serpent du destin, le personnage principal s’appelle Richard Richter. Qui est-il ?
Igor Štiks : Richard Richter est un homme qui représente sa génération, celle de l’après-guerre en Europe, celle de Mai 68. C’est un intellectuel, écrivain reconnu, un homme de gauche qui a décidé, dans les années 1960, de rompre avec son pays, l’Autriche, et son passé nazi. Il part, comme tant d’autres à cette époque, pour Paris. Deux événements changeront de nouveau sa vie, la chute du Mur de Berlin (il est déboussolé par ces bouleversements politiques) et l’échec de son mariage. Il décide de revenir à Vienne au printemps 1992.
P. : Le roman s’ouvre sur son retour à Vienne, alors qu’il est en pleine crise de la cinquantaine. Quelle découverte va bouleverser son existence ?
I. Š. : Essayant de se rétablir dans sa ville natale, il découvre accidentellement le cahier de sa mère datant de l’époque de sa naissance, pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle écrit une lettre à un inconnu. Il découvre que cet inconnu est son père biologique. C’était un juif communiste originaire de Sarajevo, qui a disparu à Vienne. Information difficile à digérer pour tout homme, mais d’autant plus pour Richter qui avait quitté son pays en raison des crimes commis pendant la guerre et qui a construit son identité politique et littéraire sur cette rupture avec la génération de ses parents, coupable d’avoir épousé le nazisme. Soudain, il découvre qu’il est le fils d’une victime. Bouleversé, il part pour Sarajevo à l’été 1992, alors que la ville est sous les bombes, avec l’espoir un peu vague de retrouver la trace de son père…
P. : Richard Richter décide de partir pour Sarajevo. La ville devient un personnage du roman, une ville qui, telle que vous la décrivez, n’existe plus. Que dire de ce monde disparu ?
I. Š. : Sarajevo, cité olympique en 1984, était une ville agréable à vivre, prospère, avec une vie culturelle très riche et renommée à l’intérieur de toute la Yougoslavie. Elle est marquée par une mixité balkanique et par un cosmopolitisme que ses habitants vivaient au quotidien. Jusqu’au conflit qui a dévasté cette singularité, Sarajevo était une exception dans l’Europe des États nationaux d’après la Seconde Guerre mondiale, dont les fondements multilingues, multiethniques ou pluriconfessionnels avaient été ravagés par les fascismes. À partir de 1992, la ville a été la cible d’une guerre menée par les nationalistes dont le dessein était précisément de ruiner cette tradition de tolérance et d’ouverture, en « nettoyant ethniquement les territoires conquis ».
P. : La ville subit l’un des plus longs sièges de l’Histoire. Vous êtes alors adolescent et vous la fuyez. Que pouvez-vous nous en dire ?
I. Š. : Le plus long siège de l’histoire moderne : quatre années, onze mille morts, la destruction d’un héritage architectural et culturel… La guerre a été marquée par des bombardements intensifs, des snipers dissimulés sur les toits ou les collines alentours, la lutte des citoyens pour leur survie élémentaire. Une nouvelle technique de terreur était exercée sur la population civile et la ville devint le laboratoire d’un type de guerre inédit.
P. : Dans ce monde déchaîné, l’amour et l’amitié ont encore leur place… Peut-on parler d’hommage à ces hommes et ces femmes qui ont résisté à l’adversité et sont aussi parvenus à imaginer un avenir meilleur ?
I. Š. : En arrivant à Sarajevo, Richard découvre une ville bombardée, mais où la vie culturelle reste intense. C’est une sorte de symbole de résistance populaire, une manière de ne rien céder de sa dignité. Les Sarajeviens continuent d’aller au théâtre ou d’assister à des lectures de poèmes, malgré les risques. Dans cette situation, Richard découvre des personnes extraordinaires, tombe amoureux d’une femme fascinante mais dangereuse pour lui, et retrouve la trace de son père. À l’intérieur de la ville assiégée, son propre drame se joue.
P. : Votre ouvrage a été couronné par de nombreux prix littéraires et traduit en douze langues, vous avez fait vos études en France et aux États-Unis et vivez aujourd’hui en Écosse, mais vous avez écrit en serbo-croate. Pourquoi avoir choisi cette langue ?
I. Š. : Mes activités sont partagées entre activités littéraires et recherches scientifiques. Pour ces dernières, j’utilise l’anglais, mais pour construire un monde littéraire, j’ai besoin de ma langue maternelle. Seule cette langue, qu’on appelle aujourd’hui croate, serbe, bosnien ou même monténégrin possède la richesse nécessaire pour mon expression littéraire. C’est une langue parlée dans toute l’ex-Yougoslavie, c’est-à-dire par plus de vingt millions d’habitants. Son héritage littéraire est considérable. On connaît en France et partout en Europe les noms d’Ivo Andric, Miroslav Krleza et Danilo Kis, mais on peut y adjoindre Boris Pahor, Predrag Matvejevic, David Albahari ou Dubravka Ugresic.