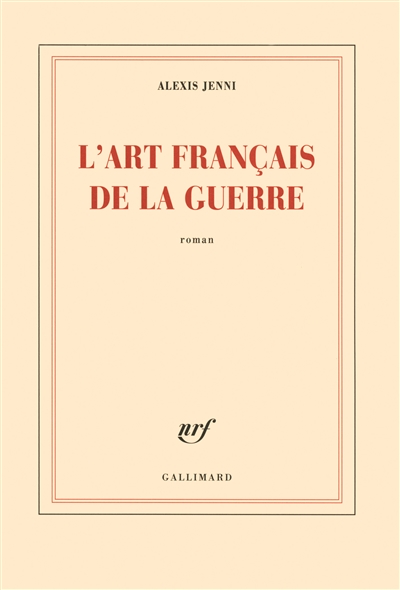PAGE : Qui se cache derrière cet imposant premier roman ?
Alexis Jenni : Je ne suis rien de spécial (rires). Gallimard m’a demandé de rédiger une notice me présentant en une dizaine de lignes. Je n’avais rien de particulier à y mettre, alors que lorsque je vois les notices d’autres écrivains, ils ont toujours fait des choses incroyables… Je suis professeur de Sciences Naturelles dans un lycée ; il n’y a rien de marquant dans ma vie. Par contre, j’ai un goût ancien et profond pour la littérature, mais qui est de l’ordre de l’intime : c’est mon espace de liberté, à tel point que lorsque mes collègues me demandent pourquoi je ne suis pas professeur de français, je réponds qu’ainsi je fais strictement ce que je veux dans ce domaine et que, si j’avais en face de moi des élèves qui n’aiment pas la littérature, je les passerais par la fenêtre ! Lorsque je leur enseigne les gènes, les enzymes et que ça ne les intéresse que modérément, ça ne me touche pas ! (rires) Ça m’embête parce que c’est mon travail, mais ça ne m’atteint pas intimement. Il y a ma vie réelle, normale, à côté de la Saône, et il y a le monde de l’écrit, le monde de l’extraordinaire où tout est possible ; d’ailleurs, le fait que j’ai étudié les sciences de la nature relève du même ordre : dès que l’on est en position de s’approcher d’une chose, on découvre un autre monde. C’est fabuleux. J’ai une vision très romanesque des sciences. Je suis un amateur d’histoires qui, à un moment de sa vie, a découvert un autre monde merveilleux.
P. : Qu’est-ce qui a déclenché l’écriture de L’Art français de la guerre ?
A. J. : J’écris depuis des années, et il y a environ cinq ans je me suis dit : je vais faire un roman d’aventure pour me faire plaisir. Bon. Ça ne menait pas bien loin. Alors je me suis dit que j’allais écrire des aventures françaises, pas par nationalisme mais parce que c’est important pour moi que les gens parlent français, j’ai un rapport très intime à la langue. Et je me suis rendu compte qu’il y avait un problème de transmission avec les guerres coloniales. Moralement c’est trouble, donc on n’en parle pas. Pourtant, certains des soldats qui se sont battus en Afrique ou en Asie, avaient commencé par s’engager aux côtés de la Résistance. Puis ils ont été en Algérie, passant du rôle de héros à celui de salaud. Dans mon éducation de rejeton de la classe moyenne de gauche, c’était comme si les choses étaient séparées, alors que ce sont les mêmes hommes. Problème : Lartéguy avait raconté ça mieux que je ne pourrai jamais le faire. Parallèlement, je pensais au monde d’aujourd’hui, cette espèce de trouble permanent, et je pensais que tout cela avait un lien. J’en suis venu à me dire qu’il fallait que je fasse quelque chose qui se déroule aujourd’hui, dire quelque chose du monde de maintenant, de ses violences. La structure du roman s’est alors éclaircie. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je n’y connaissais rien. Alors j’ai lu, je me suis plongé dans Internet et j’ai découvert un monde caché fabuleux, des mémoires de vieux militaires, des écrits de généraux, des souvenirs incroyables… Je me suis intéressé à la manière dont ces gens avaient pu vivre ces chocs successifs, passant du maquis à la jungle et au désert.
P. : Une des choses qui frappent à la lecture de votre livre, c’est justement ce rapport très fort à l’environnement – je pense notamment aux magnifiques descriptions de jungle en Indochine.
A. J. : Ce qui est drôle, c’est que je ne suis jamais allé là-bas et que je n’irai probablement jamais. Il fait chaud, humide, il doit y avoir des bêtes (rires). Mes goûts personnels me portent plus vers la Hollande, l’Écosse. Mes sources sont les serres tropicales à Lyon, les rues des quartiers asiatiques que j’aime, et toutes ces heures passées à rêver aux trésors de sensations vécues lors de mes promenades à l’intérieur de ces documents, expériences vécues qui appartiennent fondamentalement à l’Histoire de France. Je pense que l’Empire colonial français fait partie de l’imaginaire de la France, dans le sens où lorsque je rencontre un Algérien j’ai spontanément des choses à lui dire, alors que si je rencontre un Bulgare, européen et chrétien, il m’est beaucoup plus étranger. Ça passera peut-être avec les générations, mais en attendant le lien est là.
P. : Pourquoi avoir choisi une structure alternant des parties dites « commentaire » et des parties dites « roman » ?
A. J. : J’ai un rapport ambivalent au roman : les histoires d’amoureux au cœur brisé qui partent se retrouver à Venise m’ennuient. Pour moi, les parties « roman » servent à créer des personnages, à raconter ce qu’ils font, une histoire, des rebondissements. Par contre les parties « commentaire » (allusion à César et la mise en scène de la Guerre des Gaules) sont une façon de revenir au présent en utilisant un style différent, plus oral, avec une rythmique de la langue, des répétitions ; elles sont la chambre d’échos des parties « roman », leur résonance. Et j’ai ainsi pu élaborer un jeu de miroir entre le narrateur qui, au départ, ne touche pas terre, souffrant sans s’en rendre compte de l’absence de passé, et le vétéran Salagnon, un type intelligent, fréquentable, cultivé, qui se retrouve plongé dans une situation impossible avec cette question : quand on y est, on fait quoi ? Ces gens ont accompli des choses abominables, mais on ne peut pas leur dénier un certain courage, une certaine présence au monde. Est-ce qu’elle est toujours là cette présence au monde ? Je ne sais pas. J’ai l’impression d’être né dans une France sortie de l’Histoire. Je ne fais pas l’apologie de la guerre, une tentation de garçon.
P. : Un des sujets qui traverse le livre, c’est l’art, plus précisément la peinture. Pourquoi ?
A. J. : C’était présent dès le commencement de mon écriture, dans le personnage de Salagnon – il s’agit d’ailleurs plus de travail à l’encre que de peinture ou de dessin. C’était quelque chose qui devait lui permettre de voir, d’avoir une distance sur les événements. J’ai été très marqué par Marc Flament, un photographe qui a fait un livre en collaboration avec le général Bigeard sur les parachutistes (Aucune bête au monde) envoyés en Algérie pour traquer les fellagas. Ce sont de très belles photographies sur un sujet terrible.
P. : Vous nous racontez magnifiquement la jungle alors que vous n’êtes jamais allé en Indochine : vos pages sur le dessin sont également magnifiques. Peignez-vous ?
A. J. : J’ai toujours été fasciné par la peinture, mais je n’étais jamais passé à l’acte. Lorsque j’ai commencé ce roman, je me suis autorisé à dessiner.
P. : Votre style remarquable ne semble pas daté, quelles sont vos influences ?
A. J. : Elles sont très nombreuses. Toutefois, si je devais choisir un auteur, ça serait Racine. Lui plus que les autres se détache, avec son extraordinaire minutie de l’agencement et ce grondement de violence, cette langue parfaite, cette harmonie incroyable.