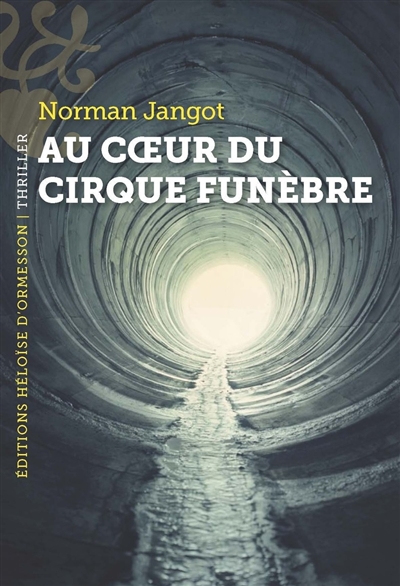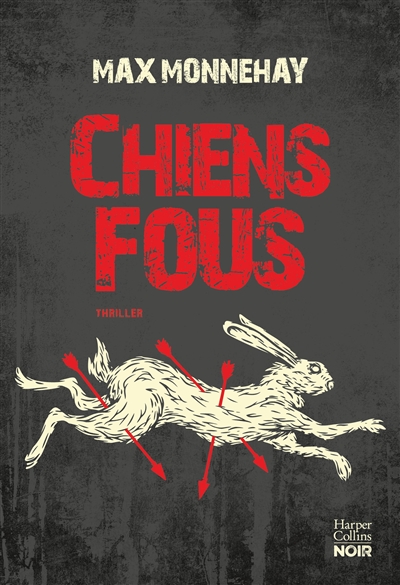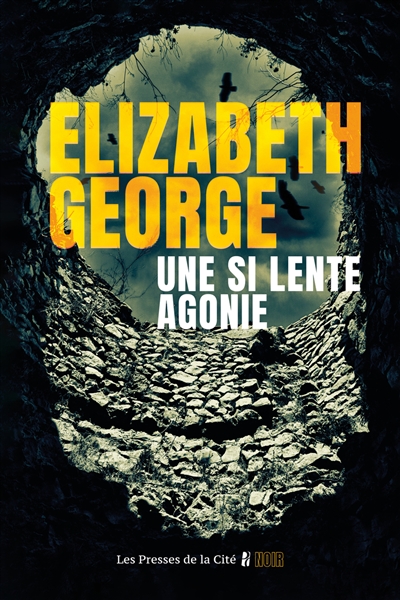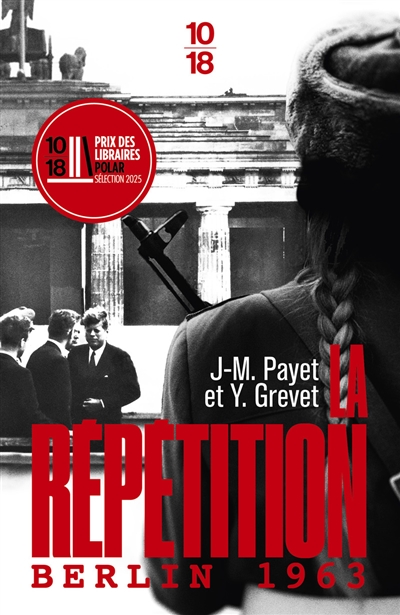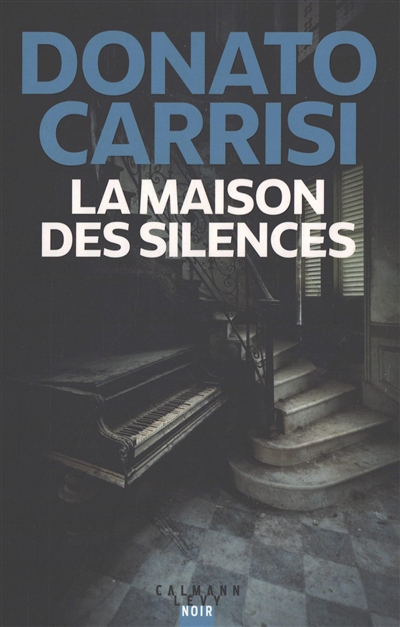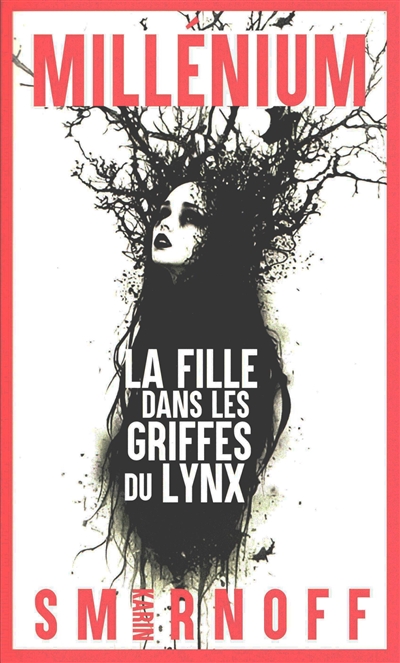Votre roman rend hommage au Comité international de la Croix-Rouge. Une manière de faire connaître leur travail ?
Karine Giebel Cet hommage est né de ma profonde admiration pour le travail des humanitaires. J’ai choisi le CICR pour son envergure et son ancienneté sur les zones de conflit. On connaît mal l’ensemble de ses missions qui ne se limitent pas à l’aide médicale ou alimentaire. J’évoque ses actions auprès des prisonniers et ses principes fondamentaux : la neutralité, le devoir de soigner tout blessé, quel que soit son rôle dans le conflit, sa nationalité, sa religion, etc.
Qu’est-ce qui anime votre héros, Grégory, un infirmier altruiste et dévoué ?
K. G. C’est un homme courageux qui a l’envie de soigner les premières victimes de la guerre, c’est-à-dire les civils. C’est une vocation forte, le besoin de se sentir utile en ce monde. Mais Grégory a aussi besoin d’aventure, d’adrénaline et ces missions lui offrent tout cela.
Bien qu’inscrit dans un passé récent, avec des guerres terminées, votre roman fait écho à l’actualité : l’Ukraine, Gaza… Les guerres s’enchaînent et se ressemblent avec leur lot de barbaries.
K. G. Dans chaque roman, j’interroge l’humain qui est en nous. Les facettes les plus sombres mais aussi les plus belles, parfois au sein d’un seul et même personnage. J’ai commencé ce roman avant l’invasion en Ukraine et, malheureusement, il fait effectivement écho à la réalité. Mais d’autres guerres, même si elles sont moins médiatisées, il y en a beaucoup sur le globe. Ces conflits, à chaque fois accompagnés de crimes de guerre, durent parfois depuis des décennies et le monde les oublie. Ce sont souvent les civils qui sont en première ligne, obligés de fuir, de s’entasser dans des camps, menacés par la famine, les épidémies… Et quand la guerre s’arrête, la souffrance ne cesse pas : les mines antipersonnel, les proches dont on n’a plus de nouvelles, les maladies, les camps… Cela aussi, j’ai tenté de le montrer au travers des missions de Grégory. Ce n’est pas un roman sur la guerre, plutôt sur un combat au cœur des guerres : celui des humanitaires.
Vous faites dire à votre personnage : « Comment effleurer la réalité du monde ? Tant qu’on n’a pas vu, on ne sait pas. » On a de l’empathie pour lui. Il vit avec ses fantômes.
K. G. Un des thèmes que je souhaitais aborder, c’était le stress post-traumatique. Comment fait-on pour continuer sa vie après avoir été confronté aux horreurs de la guerre ? Ce syndrome touche les militaires, les civils mais aussi les humanitaires. Grégory a beaucoup d’empathie pour les autres et je pense que le lecteur en aura pour lui qui, malgré les désillusions et le danger, continue à mettre sa vie et sa santé mentale en péril pour soigner ceux qui en ont besoin. Sa récompense, son moteur, ce sont ses victoires sur la guerre : ceux qu’il arrive à sauver, les familles que ses collègues et lui parviennent à réunir. Et puis les rencontres qu’il fait dans chaque pays et qui marqueront sa mémoire.
L’écriture de ce roman a dû nécessiter une longue enquête, sûrement éprouvante.
K. G. Oui, il a fallu un long travail d’investigation et il n’a pas été facile d’être confrontée à cette réalité. J’ai beaucoup lu, écouté des témoignages. Je me suis appuyée sur les archives du CICR mais aussi sur des films réalisés par d’autres ONG. J’ai étudié les cultures et la géographie de chaque pays. Un travail de longue haleine, parfois éprouvant, souvent passionnant.
Votre roman constitue la première partie d'un diptyque. Pourquoi ce choix ? Que signifie le titre de ce livre 1, Blast ?
K. G. Le blast, c’est l’effet de souffle après une explosion, l’onde de choc. Ce titre fait écho à bien des situations du roman. Et chaque fois, mourir un peu se déroule sur une trentaine d’années et j’ai voulu suivre mon personnage au plus près : pour cela, il fallait un certain nombre de pages, d’où le diptyque.
Grégory, jeune infirmier engagé dans l’humanitaire, voyage aux quatre coins du globe. Au chevet des victimes de guerre, il se sent utile. En assistant les médecins, il apprend qu’il ne peut pas sauver tout le monde, apprend la douleur de l’échec. Quand il n’est pas en mission, il vit sa vie de famille avec sa femme et sa fille. Mais il ne pense qu’à retourner au combat. Lors d’un massacre en Bosnie, Grégory se retrouve à devoir endosser le rôle de responsable-trieur qui donne la priorité à ceux qui ont le plus de chances de survivre. La tragédie menace et advient en paroxysme de violence. Karine Giebel n’a pas son pareil pour camper des personnages humains, crédibles, attachants. Voilà un roman exceptionnel. Dur, difficile mais magistral.