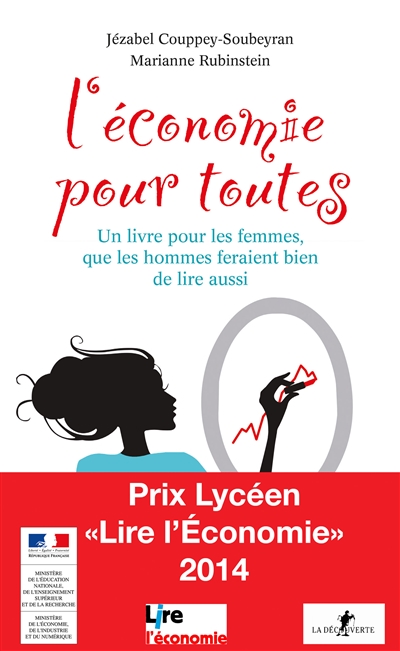Les écrivains voyageurs
Marianne Rubinstein à Détroit...

...nous raconte les coulisses de l'écriture de son roman Détroit, dit-elle, publié le 13 octobre 2016 aux éditions Verticales.
Pourquoi Detroit ? En août 2014, alors qu’on a navigué dans le golfe de Gênes et qu’on s’apprête à finir l’été dans le Cotentin, j’éprouve soudain le désir d’aller là-bas. Un désir étrange, sans raison apparente (je n’y connais personne), mais suffisamment impérieux pour que je rédige dans l’urgence un projet de mission Stendhal (il reste dix jours à peine avant la date de clôture des candidatures) et que je sollicite mes éditeurs pour une lettre de soutien, tout cela en pleine période de vacances, sans compter la WIFI qui marche mal…
Oui, pourquoi Detroit, cette ville abîmée, réputée la plus dangereuse des États-Unis, avec ses maisons éventrées, ses écoles murées, ses usines désaffectées et ses nids-de-poule sur la chaussée, qui, dans certains anciens quartiers d’habitation, prend des airs de route de campagne ? N’aurais-je pu trouver destination plus agréable ?
Plus agréable, sans doute. Plus stimulante et revigorante, après les deux ans et demi dont je m’extrais alors, séquencés par le cancer, la chimiothérapie et les opérations, c’est moins sûr. Car au sortir de cette période, je peine à comprendre le monde, je discerne mal le point de passage pour entrer de nouveau dans la danse. Et où, mieux que là-bas, pourrais-je saisir de manière presque palpable ce passage de relais entre le capitalisme industriel dont la ville fut le symbole et un capitalisme financier qui a contribué à la détruire ? (Par exemple, le subprime a occasionné à Detroit la saisie de 65 000 maisons.) Où, mieux que là-bas, l’exigence de survie est-elle brandie comme un étendard, jusque dans la devise que la ville s’est choisie (« Speramus meliora, resurget cineribus » ? « Nous espérons des temps meilleurs, elle renaîtra de ses cendres. »)
« Et où, mieux que là-bas, pourrais-je saisir de manière presque palpable ce passage de relais entre le capitalisme industriel dont la ville fut le symbole et un capitalisme financier qui a contribué à la détruire ? »
Survie de la ville et du corps, donc, en écho à celle d’un capitalisme qui s’était bâti au XXe siècle sur la consommation de masse et qui se trouve confronté à une démographie galopante, à des problèmes écologiques majeurs, à des travailleurs qui n’obtiennent plus, en contrepartie de leur labeur, suffisamment de revenus et de protection sociale pour sortir de la survie, à une « économie collaborative » qui cherche avant tout, grâce aux plates-formes numériques, à mieux utiliser les ressources existantes.
Et la littérature là-dedans ? Ne suis-je pas en train de donner l’impression fausse de l’oublier, alors qu’elle fut et reste ma première exigence ? Écrire pour tisser ensemble l’intime et le collectif, pour incarner l’économie à travers une ville qui en représente le passé, le présent et peut-être même l’avenir (le faible coût du foncier permettant toutes les audaces), et mon propre corps survivant, voilà ce que j’ai tenté de faire. Manière aussi de rassembler ce que je suis, l’économiste et la romancière, pour raconter cette histoire qui est désormais la nôtre. Nous sommes entrés dans une économie de la survie.
Les livres de Marianne Rubinstein

La Sixième, Dinah et moi

Bord de mère
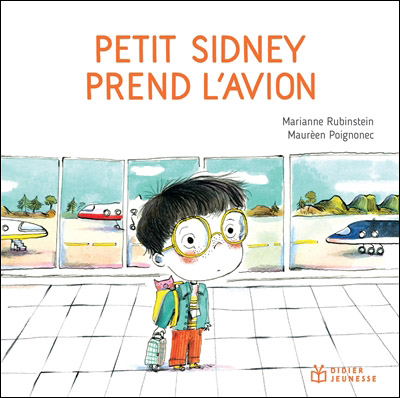
Petit Sidney prend l'avion
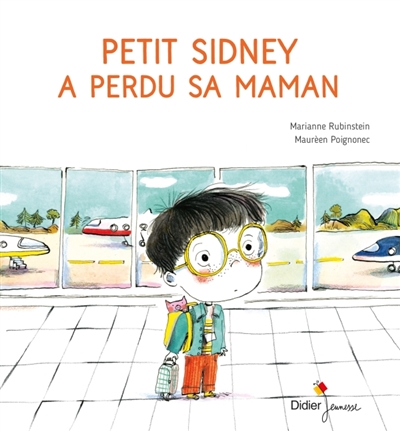
Petit Sidney a perdu sa maman

Le Courage d’être moi

Detroit, dit-elle
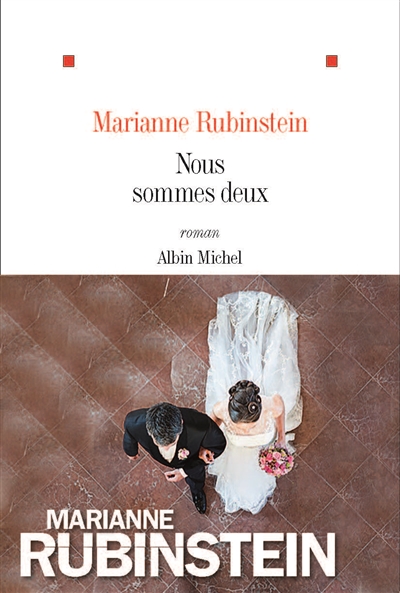
Nous sommes deux

Jusqu’au bout du secret
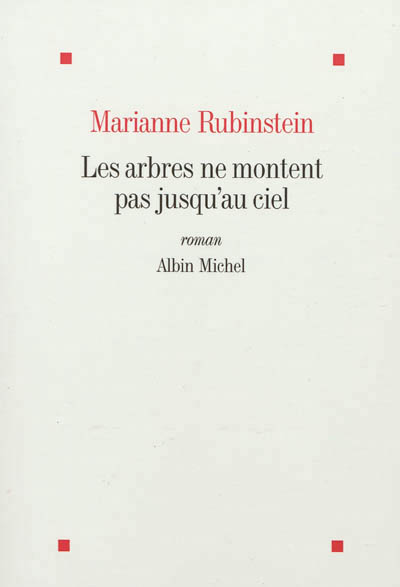
Les Arbres ne montent pas jusqu’au ciel