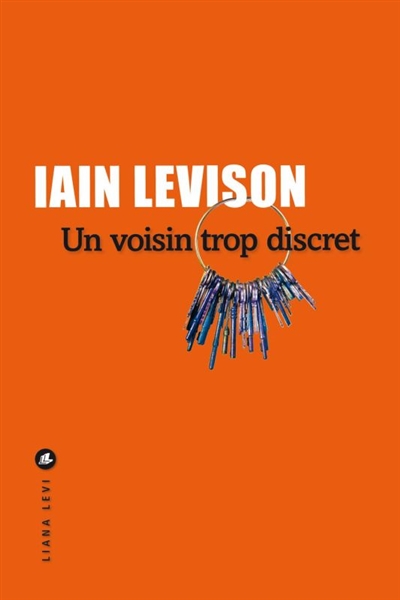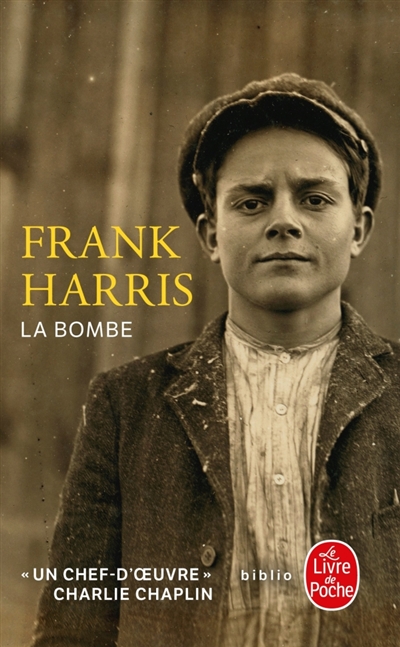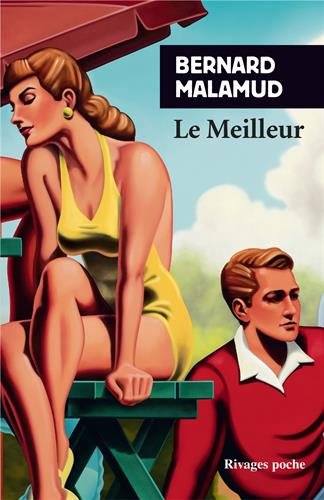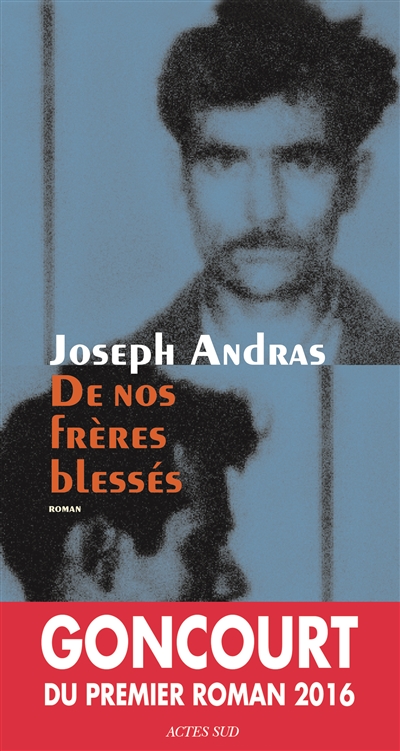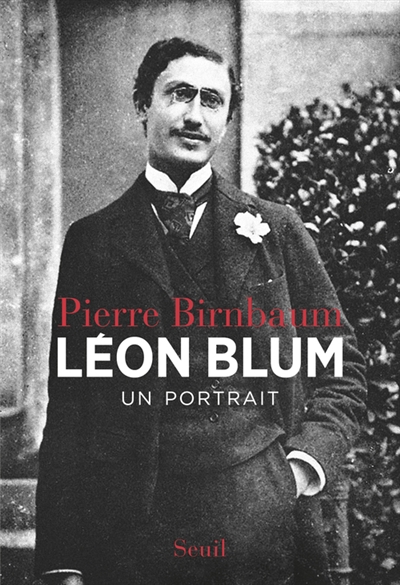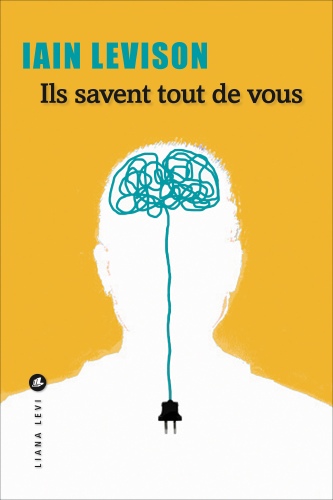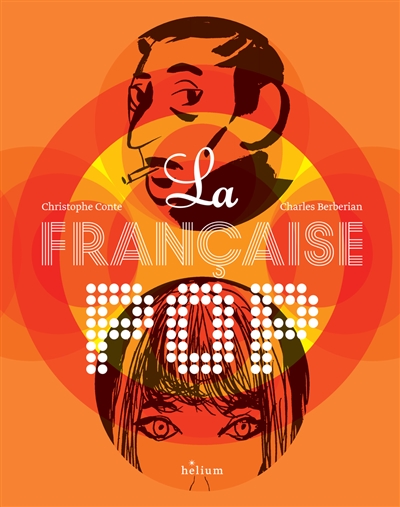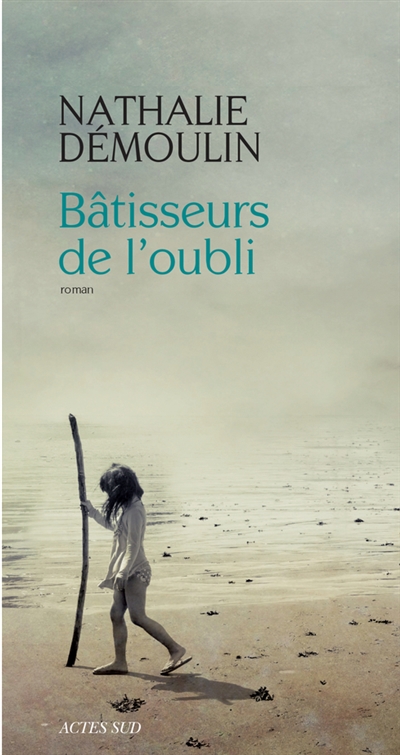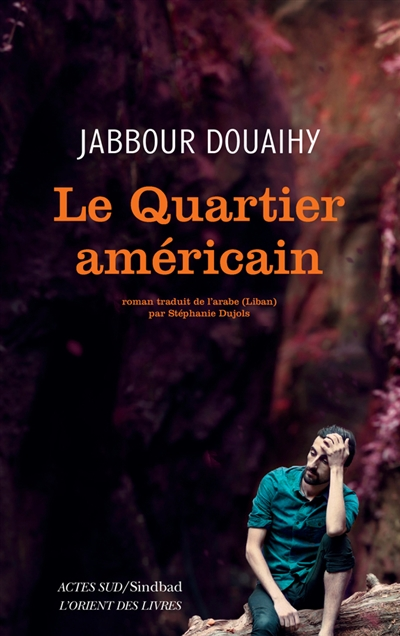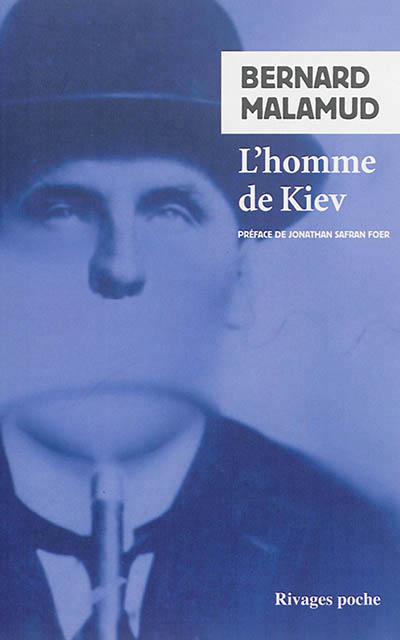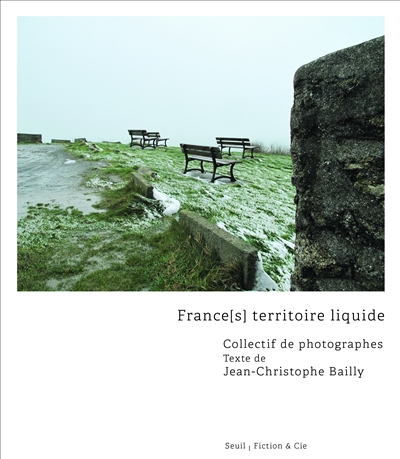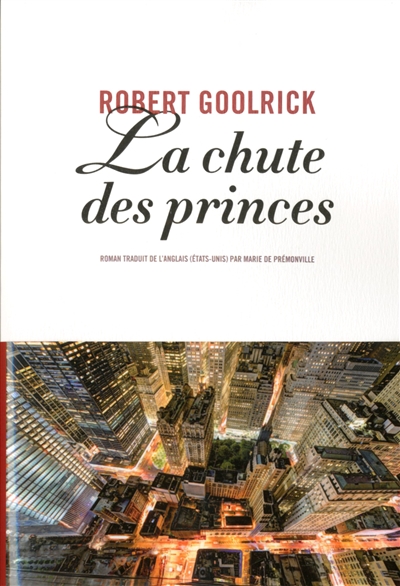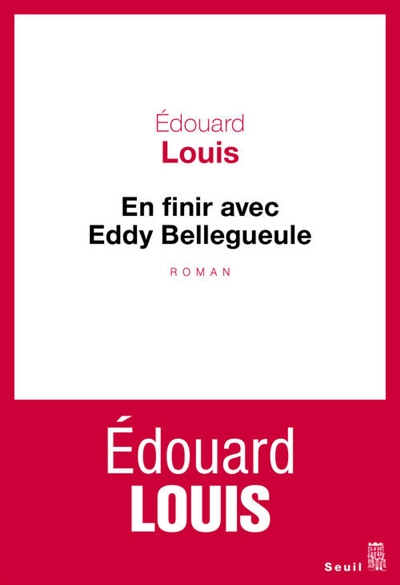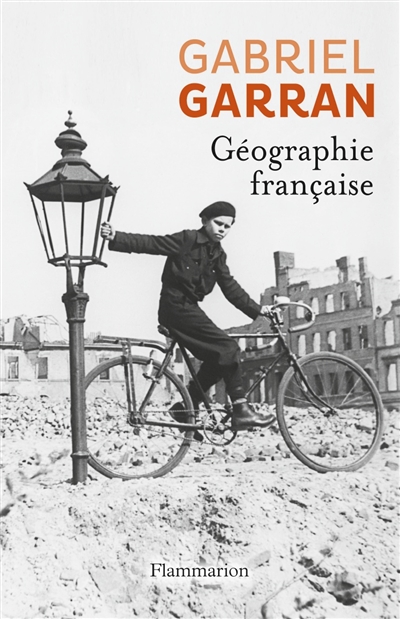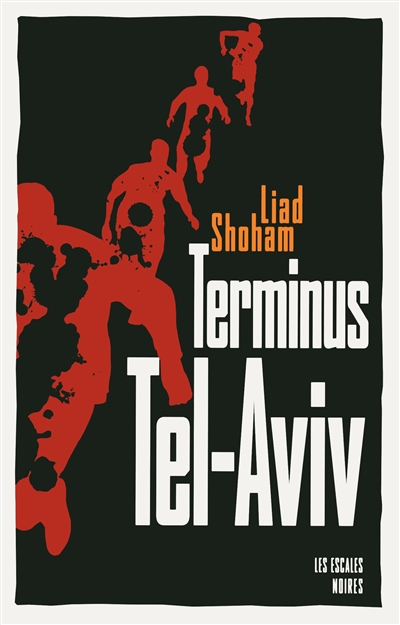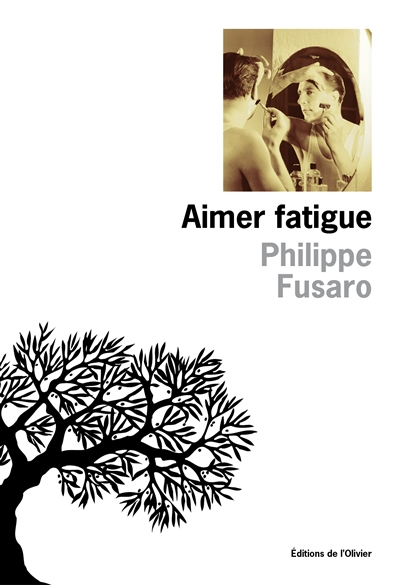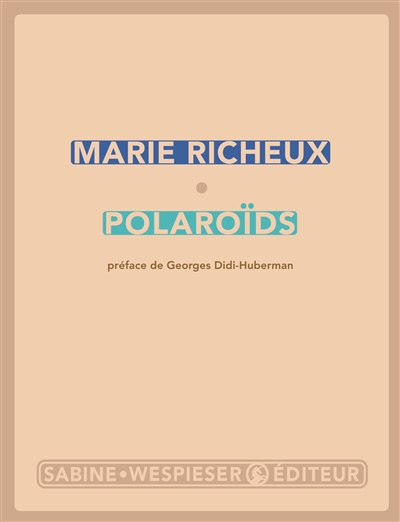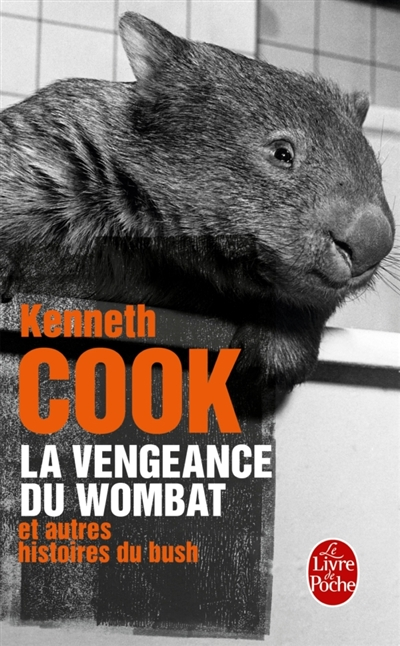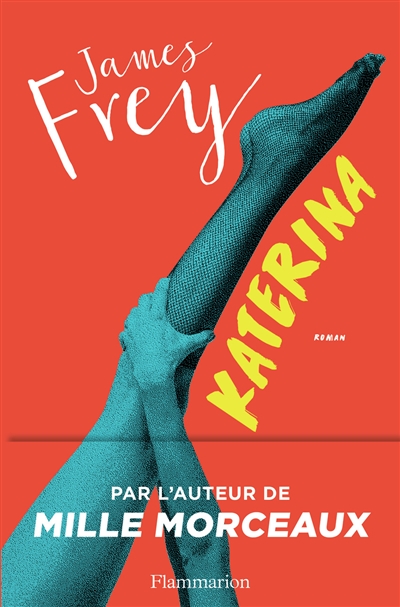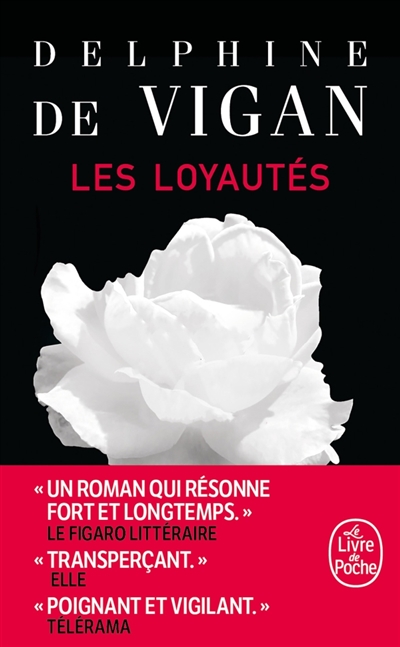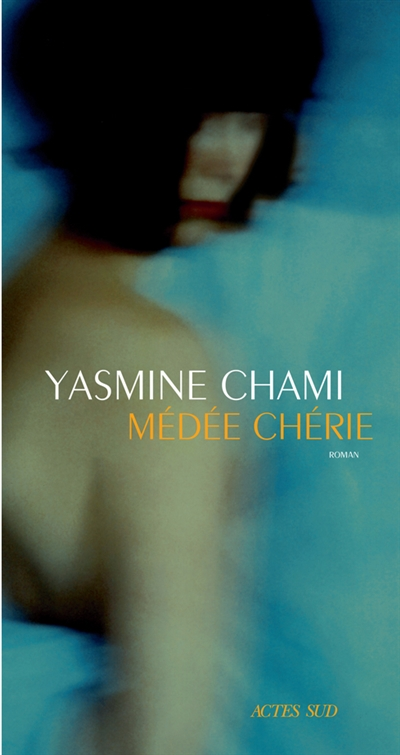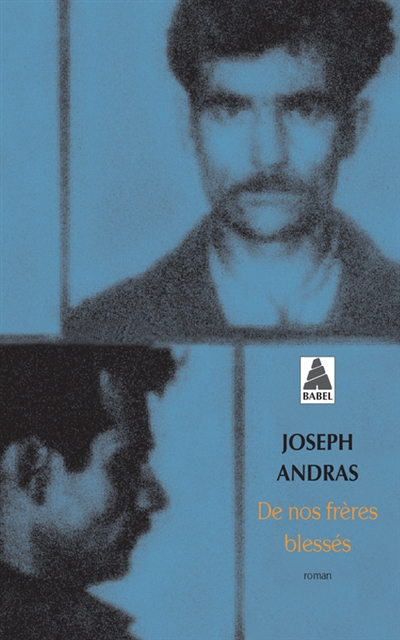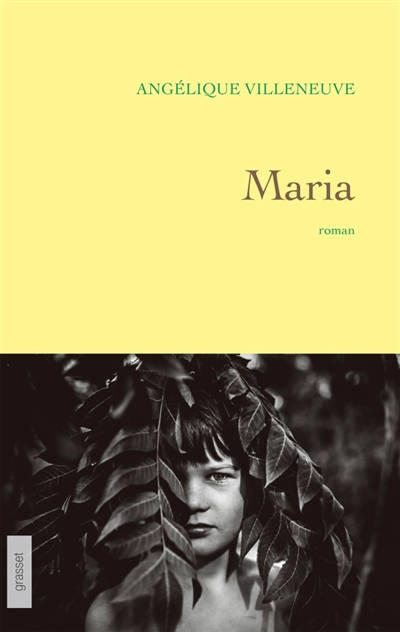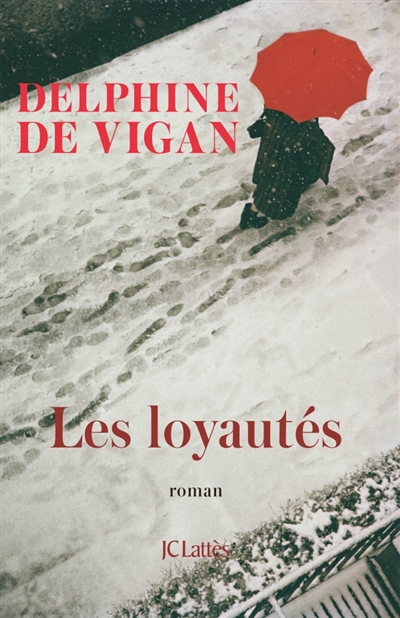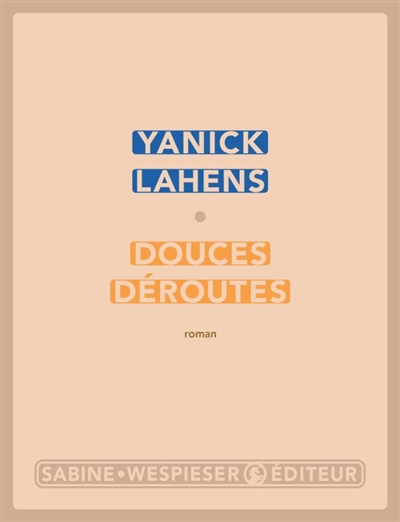Littérature française
Maylis de Kerangal
Réparer les vivants
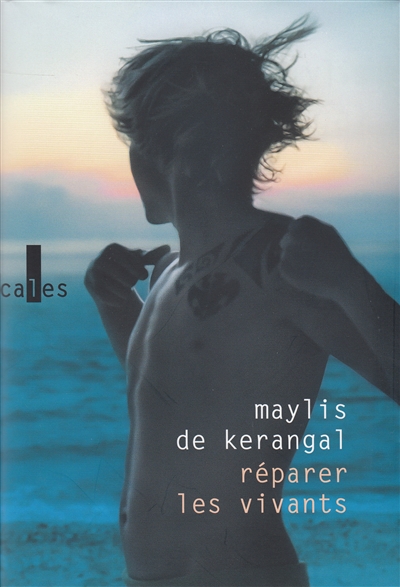
-
Maylis de Kerangal
Verticales
01/01/2014
280 p., 18.90 €
-
Chronique de
François Reynaud
Librairie des Cordeliers (Romans-sur-Isère) -
Lu & conseillé par
38 libraire(s)

Chronique de François Reynaud
Librairie des Cordeliers (Romans-sur-Isère)
Après le récit de la construction d’un pont dans Naissance d’un pont (Folio, 2012), Maylis de Kerangal s’attache à décrire le parcours d’un cœur qui change de corps. Des romans qui traitent leur sujet avec autant de douceur et dans une langue aussi belle qu’inventive, on n’en lit pas deux par an.
C’est l’histoire d’un cœur qui change de corps. Qui quitte accidentellement, au petit matin, celui d’un jeune homme plein de vie, et trouve refuge, le soir venu, dans celui d’une femme d’une cinquantaine d’années qui finissait par ne plus y croire. Ce livre est donc l’histoire d’une trajectoire. Et comme une pierre plate lancée sur l’eau de façon à ce qu’elle produise des ricochets, provoquant à chaque rebond un fracas sur l’onde, Maylis de Kerangal suit ce parcours au plus près de celles et ceux que ce cœur ébranle. Avec une grande pudeur, et sans jamais épargner son lecteur, elle convoque la douleur et l’amour des parents confrontés à l’irrémédiable disparition et à la question du don, aussitôt posée. Urgente. Elle raconte la mécanique médicale qui se met en branle. Suite de gestes magnifiques et fragiles accomplis par des femmes et des hommes qui se raccrochent à leur art pour donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est tellement bien écrit, on ne devrait pas pleurer comme ça.
Page — En 2010, Naissance d’un pont avait pour dynamique et mouvement la construction d’un pont. Avec Réparer les vivants, le sujet de votre livre repose à nouveau sur une dynamique et un mouvement : le parcours d’un cœur, d’un corps vers un autre. L’écriture d’un roman commence-t-elle chez vous par ce mouvement ?
Maylis de Kerangal — Je crois que l’écriture est d’abord un mouvement. Il y a une sorte de piétinement intérieur qui soudain trouve un élan, un espace, il y a une forme de mise en branle de soi, de la langue, du monde. J’aime aussi l’idée que les livres sont des mouvements – de la pensée, de la perception, de l’imaginaire – qu’ils décrivent des trajectoires, lignes ou cerceaux. Effectivement le début et la fin d’un roman reconduisent pour moi cette idée-là, celle d’une parabole bouclée dans le temps d’une lecture.
Page — Une transplantation provoque une onde de choc continue qui touche de nombreuses personnes (famille du donneur, famille du receveur, personnel médical). Comment vous y êtes-vous prise pour vous glisser tour à tour dans la peau de chacun de ces personnages et rendre le fracas intime déclenché par ce séisme, la fébrilité ou la maîtrise avec laquelle il est accueilli ?
M. de K. — Je ne sais pas exactement. J’ai imaginé ces personnages, ces situations. Je les ai visualisés précisément. J’ai fait appel à mes perceptions, à mon expérience, à mes influences – le cinéma souvent, la photographie ou la peinture. Je voulais que ces personnages soient des individus singuliers, pleinement sujets. Puis, je leur ai trouvé des noms, et alors ils ont eu un corps pour m’accueillir !
Page — La lecture de Réparer les vivants, si elle est très belle, est aussi très éprouvante. Les émotions provoquées par ce parcours d’un cœur m’ont personnellement ému à de nombreuses reprises. Dans quel état physique étiez-vous, vous-même, durant l’écriture de ce roman ?
M. de K. — Oui, écrire ce roman-là a été parfois éprouvant. J’étais un peu « sonnée ». Mais écrire est toujours une expérience physique. Il y a une fatigue très spéciale, que je recherche, liée à la concentration et à la tension que requiert l’écriture – j’ai d’ailleurs l’impression d’accomplir toujours un même type de course : démarrages lents et recherche, accélération en continu et densification, sprints fiévreux.
Page — Quelle a été l’origine de ce roman ? Comment l’idée d’écrire sur le don d’organe, sur le parcours d’un cœur, est-elle apparue ?
M. de K. — Il est assez complexe de comprendre comment naît un livre, de saisir ce qui cristallise suffisamment pour devenir objet d’écriture. Je suis frappée depuis longtemps par tout ce qu’enveloppe la transplantation : le processus qu’elle déplie, l’espace-temps qu’elle organise, les gestes et les paroles, les savoirs et les techniques qu’elle implique. Cette migration interroge le corps, l’altérité, l’étranger, la frontière, ce que signifie être vivant, toute piste que mon travail explore. J’ai écrit un petit texte sur le sujet en 2007, publié dans un volume collectif intitulé Qui est vivant ? édité à l’occasion des 10 ans de Verticales. Je travaillais sur un autre projet quand l’idée de ce roman a fait retour, dans le sillage de deuils récents. Je crois que c’est le cœur, cette expression de cœur humain qui a déclenché l’écriture. Cœur-muscle et cœur-symbole, organe et boîte noire, pompe et siège des affects. Cette double dimension du cœur a instauré la possibilité du roman.
Page — Y a-t-il eu de votre part, à travers ce livre, une envie d’atteindre le lecteur dans sa sensibilité la plus profonde pour l’amener à s’interroger sur son propre positionnement par rapport à la question du don d’organe ?
M. de K. — Je n’ai pas écrit un manifeste en faveur du don d’organe, ce n’était pas mon projet. J’ai davantage essayé d’envisager le don dans sa complexité, dans la violence qu’il impose, dans la réparation qu’il peut permettre, dans les représentations du corps qu’il met en jeu. C’est en ce sens que j’ai essayé d’atteindre le lecteur. Il n’y a pas de bonne morale dans ce texte : les parents, certes, consentent au don, mais s’exprime aussi leur résistance. Ce qui m’intéresse c’est l’idée d’altérité à l’œuvre dans cette histoire de don, et l’empathie que le roman peut formuler – car je crois qu’écrire a à voir de très près avec cela.
Page — J’admire cette façon que vous avez de maîtriser les lexiques techniques indispensables à votre projet d’écriture et d’en faire une matière littéraire. Dans ce roman précisément, comment vous y êtes-vous prise pour acquérir cette langue médicale ? Avez-vous suivi de près, durant de longues semaines, des équipes de service de réanimation ? Avez-vous longuement discuté avec des professeurs de l’agence de biomédecine ?
M. de K. — J’ai pensé à l’idée de cardiographie, à ce que serait une écriture du cœur : circulation, palpitation, pulsation, battement, souffle. Il ne s’agit pas de tenir un discours mais de décrire, de chanter. J’use de registres différents (lyrisme, trivialité) et de lexiques pluriels (vocabulaire technique, expressions en langues étrangères) pour créer la matière du texte, son épaisseur feuilletée – je me représente toujours le texte en trois dimensions ! Pour ce roman, j’ai eu la chance de parler longuement avec un coordonnateur de prélèvements et de greffes, et d’assister à une transplantation cardiaque. J’ai envisagé l’hôpital, le bloc opératoire, comme des continents de langage : comment on y parle, comment on y annonce, comment la parole s’y manifeste. Mais selon moi, la précision documentaire vaut moins pour le « quotient de réel » qu’elle donne au texte, que pour l’imaginaire qu’elle débride.